Sandra Blais et André Gauthier, propriétaires de la ferme Purmer, sur l’île Grosse Boule à Sept-Îles, sont de gens dont la résilience est réellement surdimensionnée. Leur entreprise d’élevage de moules créée en 1994 par un pêcheur commercial de la région, Serge Gagnon, qu’ils ont acquise en 2007, ne l’a pas eu facile à ses débuts.
Passionnée de la mer, restauratrice de longue date, Sandra Blais (photo) se lance corps et âme dans la mariculture et commence à y cultiver des moules. Au fil des années, elle y installe des yourtes et développe le potentiel touristique d’une ferme unique en son genre : un camp de jeune, un site de villégiature, des excursions en mer et toute une gamme d’activités de plein air !
Mais un événement malheureux survenu en automne 2013, alors que ça devait être l'aboutissement de cinq années de dur labeur pour les entrepreneurs qui envisageaient de commencer la commercialisation de la moule, élevée depuis 2008 dans la baie de Sept-Îles, les a forcés à la mettre aux poubelles plutôt que sur la table en raison des risques de contamination laissés par les 5000 litres de mazout qui ont fui des installations industrielles de la minière Cliffs Natural Resources dans la baie de Sept-Îles.

« C'est certain qu'on est encore amer d'avoir travaillé autant et de ne pas en avoir récolté les fruits », déclarait Sandra Blais à l’époque. « Les premiers mois ont été difficiles, mais ça nous a appris que dans la vie, aujourd'hui t'es là, et demain, tu ne sais pas », ajoutait-elle avec optimisme. Le couple a donc remis à l'eau, en juillet 2014, 50 000 livres de moules qu'ils souhaitaient cueillir à l'automne 2017.
C’était alors sans se douter qu’en 2018, ils devraient encore remettre ça puisque leurs installations ont été envahies par les algues. Il en fallait davantage pour les décourager. La diversification des cultures allait être leur bouée de sauvetage. Alors qu’on avait déjà introduit le pétoncle, on allait ajouter la culture d’algues pour la consommation. Les huîtres se sont maintenant ajoutées aux cultures.

Au cours des dernières années, les productions ont repris de la vitesse, sauf pour le pétoncle qui n’a pas été produit en 2023, l’eau de la baie étant trop chaude. Eux qui ne s’y connaissaient aucunement au début en mariculture ont vite appris de formations sur Internet et d’un séjour d’André, le menuisier de carrière, sur la Basse-Côte-Nord avec des pêcheurs qui lui ont appris les rudiments de la mariculture.
Grosse Boule, un paradis
Depuis 2018, en plus de l’univers fascinant de la mariculture, le décor enchanteur de l’île Grosse Boule, en plein cœur de l’archipel des Sept Îles dévoile tous ses secrets. Outre déguster les produits, on y apprivoise la culture des algues ainsi que l’élevage de moules et de pétoncles. Ceux qui s’y rendent en excursion ne voient plus les fruits de mer de la même façon par la suite.

L’accès au site s’effectue par bateau pneumatique. Le trajet depuis la marina de Sept-Îles dure environ 15 minutes selon les conditions météorologiques.

Le camp éducatif Purmer accueille les jeunes âgés de 8 à 13 ans pour un séjour de 4 nuitées sur l’île Grosse Boule. Les enfants ont le plaisir de découvrir les secrets de la mariculture et les beautés naturelles de l’archipel des Sept Îles et de vivre l’excitation de passer la nuit sous l’une des yourtes modernes et bucoliques.

Les biologistes sur place interprètent et expliquent le processus d’élevage de moules et d'algues lors d’une excursion en zodiac autour des installations de la ferme. Les visiteurs sont ensuite invités à une dégustation de pétoncles. Suite à cette inoubliable rencontre culinaire, les visiteurs de l’île se voient accorder un moment pour découvrir le site par eux-mêmes, pouvant ainsi prendre des photos. La ferme offre également des accommodements d’hébergement en yourtes pour 4 à 8 personnes.
André Gauthier et Sandra sont aujourd’hui de fiers producteurs maricoles. Ils ont même refusé une offre d’achat généreuse pour leur île, plusieurs fois plus élevée que le prix payé. Tout ça parce qu’ils veulent laisser ce petit paradis en héritage à leurs descendants. Leur fille, Meggie, est déjà impliquée dans l'entreprise familiale en y venant passer ses étés pour collaborer avec ses parents.
Ferme maricole Purmer
ferme-purmer.com
Ile La Grosse Boule
Sept-Îles (QC) G4R 2P8
(418) 960-4915
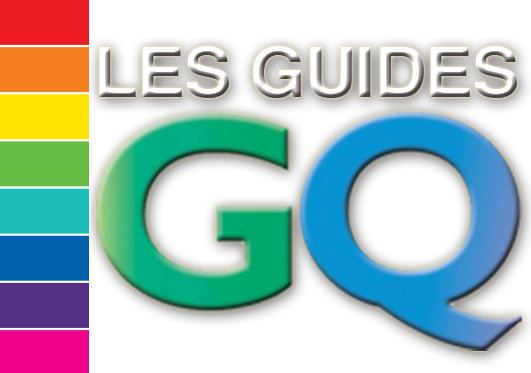






 Les Vibert, trois générations de gens passionnés
Les Vibert, trois générations de gens passionnés



 Normand Junior Tshirnish-Pilot, coordonnateur
Normand Junior Tshirnish-Pilot, coordonnateur










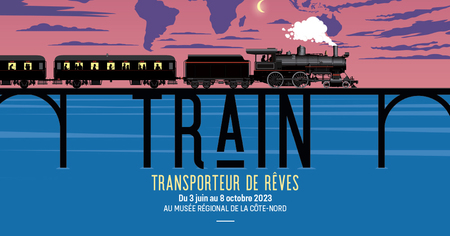






 Le vieux manoir anglais construit entre 1909 et 1914 s’appelait alors South Beach et accueillait surtout des riches touristes américains et européens.
Le vieux manoir anglais construit entre 1909 et 1914 s’appelait alors South Beach et accueillait surtout des riches touristes américains et européens. 





 Plan image d'architecte - Nouvelle usine
Plan image d'architecte - Nouvelle usine





 Le directeur général, Bechir Ben Aicha
Le directeur général, Bechir Ben Aicha




